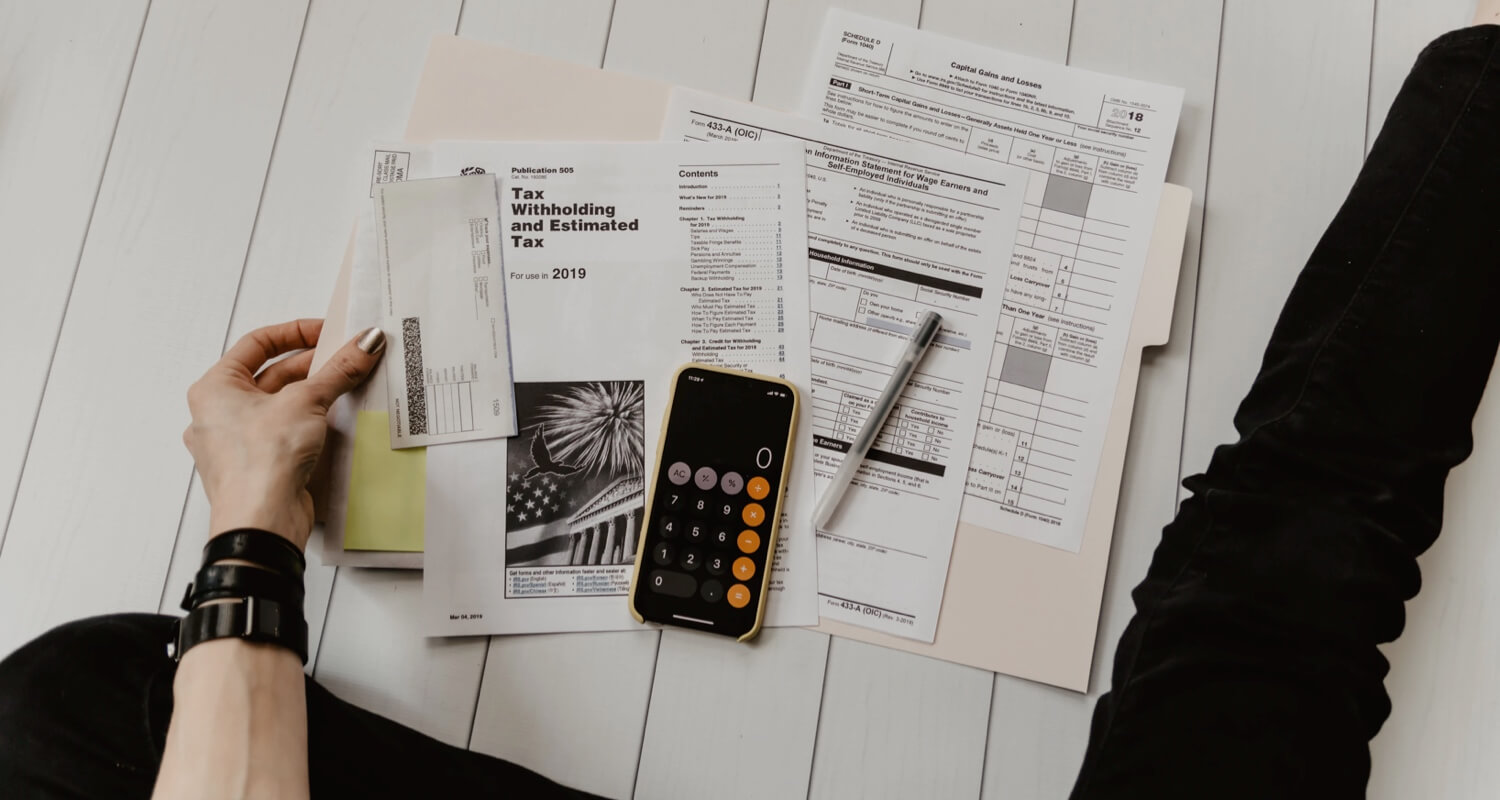La frontière entre la mise à disposition d’espaces assortie de services et la sous-location prohibée demeure l’un des contentieux les plus sensibles du bail commercial.
Avec l’essor des modèles hybrides (corners, pop-up stores, coworking, studios à usage partagé), les locataires recourent de plus en plus à des conventions dites « de prestations de services » dont la validité dépend en réalité d’un critère unique : le maintien ou non de la maîtrise de la jouissance des locaux par le locataire principal.
Dans un arrêt du 25 septembre 2025 (CA Paris, Pôle 5 – Ch. 3, n° 22/01617), la Cour d’appel de Paris apporte une clarification particulièrement structurante. Elle confirme que lorsque la mise à disposition des locaux constitue l’objet principal du contrat, qu’elle entraîne un transfert effectif de jouissance au profit d’un tiers et que les services proposés ne sont que secondaires ou accessoires, la convention doit être requalifiée en sous-location, peu importe son intitulé ou la qualification retenue par les parties.
- Les faits : un congé délivré avec indemnité d’éviction… puis remis en cause
Le litige naît dans un contexte apparemment classique de fin de bail commercial. À l’échéance du contrat, le bailleur délivre à son locataire un congé avec refus de renouvellement, en assortissant ce refus d’une offre d’indemnité d’éviction, conformément au mécanisme protecteur du statut des baux commerciaux prévu par les articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce. À ce stade, rien ne laissait présager une remise en cause de cette indemnité, le bailleur ayant pris soin de respecter l’ensemble des exigences formelles attachées à la délivrance du congé.
La situation évolue toutefois de manière significative lorsque le bailleur découvre que, durant l’exécution du bail, le preneur avait mis les locaux loués à la disposition de plusieurs sociétés tierces, sans l’en informer. Cette pratique s’était manifestement installée sur la durée, et non à titre exceptionnel ou anecdotique. Or, le contrat de bail comportait une clause particulièrement claire et rigoureuse, interdisant expressément toute sous-location, qu’elle soit totale ou partielle, et prohibant de surcroît tout prêt, mise à disposition ou substitution de jouissance, même temporaire. Le bail n’autorisait donc aucun transfert d’occupation au profit de tiers, sous quelque forme que ce soit, sans l’accord écrit et préalable du bailleur.
Face à ces informations, le bailleur entreprend d’examiner les conventions passées entre le locataire et les tiers concernés. Le preneur soutient qu’il ne s’agit en aucune manière de sous-locations, mais de contrats de prestations de services, dont la finalité aurait été de permettre à certaines entreprises ou intervenants extérieurs d’utiliser ponctuellement les lieux pour des besoins accessoires, prétendument intégrés à l’activité principale du locataire. Le preneur fait valoir que la mise à disposition de l’espace ne constituait pas, selon lui, l’objet principal de ces accords, mais un simple support matériel de prestations commerciales plus larges.
Le bailleur adopte une lecture radicalement différente des mêmes conventions. Selon lui, ces contrats, malgré leur dénomination, avaient pour effet réel et direct de transférer la jouissance des locaux à des sociétés tierces, pour des périodes déterminées et moyennant rémunération, ce qui correspond précisément à une sous-location au sens de l’article L. 145-31 du Code de commerce. Il relève que le locataire n’avait jamais sollicité son accord, ni même porté à sa connaissance l’existence de ces occupations successives, en méconnaissance totale du formalisme légal imposant d’appeler le bailleur à concourir à tout acte de sous-location.
Estimant que ces pratiques caractérisent un manquement grave et irréversible aux obligations du preneur, le bailleur saisit la juridiction compétente afin d’obtenir la constatation d’un motif grave et légitime, au sens de l’article L. 145-17 du Code de commerce, de nature à priver le locataire de tout droit à l’indemnité d’éviction initialement offerte. Il sollicite donc que le juge constate que le preneur, en concluant et multipliant ces contrats de mise à disposition assimilables à des sous-locations prohibées, a rompu la confiance contractuelle et méconnu de manière substantielle et répétée les obligations essentielles résultant du bail, justifiant ainsi la remise en cause de l’indemnité d’éviction.
- Le cadre légal : une interdiction de principe renforcée par le formalisme du concours du bailleur
Le régime juridique applicable à la sous-location en matière de bail commercial repose sur un principe clair, posé par l’article L. 145-31 du Code de commerce, selon lequel la sous-location est strictement interdite, à moins qu’une stipulation expresse du bail ou un accord spécifique du bailleur ne vienne y déroger. Cette interdiction, qui constitue le droit commun du statut, traduit la volonté du législateur de préserver la relation contractuelle initiale entre le propriétaire et son locataire, en évitant que le local ne soit exploité par un tiers sans que le bailleur ne puisse en contrôler l’identité, la solvabilité ou les conditions d’occupation.
Même dans l’hypothèse, relativement rare en pratique, où le bail autoriserait la sous-location, ou lorsque le bailleur y consentirait ponctuellement, cette autorisation n’est jamais suffisante à elle seule pour rendre la sous-location régulière. Le législateur a en effet prévu un formalisme spécifique et impératif : le bailleur doit être appelé à concourir à l’acte de sous-location. Cela signifie qu’il doit être mis en mesure de connaître l’identification précise du sous-locataire, les conditions essentielles du contrat envisagé, les modalités d’occupation projetées, ainsi que la date et le lieu de signature de l’acte. Ce formalisme assure au bailleur un droit de regard effectif et concret sur l’opération, qui ne peut valablement produire d’effets à son égard que s’il a été en mesure de participer à sa conclusion, ou à tout le moins d’y renoncer en connaissance de cause.
Ce mécanisme du concours du bailleur, qui remonte historiquement au décret de 1953, constitue une garantie essentielle. Il prévient les dérives consistant pour un locataire à organiser une occupation parallèle du local ou à en tirer un avantage économique substantiel sans contrôle du propriétaire. En l’absence d’appel à concourir, la sous-location encourt la nullité et s’analyse comme une sous-location prohibée, même si elle avait été présentée sous une autre qualification contractuelle.
Sur le terrain du droit au renouvellement et de l’indemnité d’éviction, l’article L. 145-17 du Code de commerce introduit une conséquence majeure. Ce texte prévoit que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’une indemnité d’éviction, dès lors qu’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. La jurisprudence admet de longue date que la conclusion d’une sous-location irrégulière, notamment lorsqu’elle a été réalisée sans appel du bailleur à concourir à l’acte ou lorsqu’elle intervient en violation d’une clause contractuelle expresse, constitue un tel motif grave et légitime.
Ainsi, le cadre légal articule trois niveaux de protection cohérents : une interdiction générale de sous-louer, une exigence de transparence et de formalisation renforcée même en cas d’autorisation, et une sanction particulièrement sévère en cas de violation de ces obligations, pouvant aller jusqu’à la privation totale du droit à indemnité d’éviction. Ce dispositif explique la vigilance constante des juridictions lorsqu’elles sont amenées à requalifier des conventions ambiguës en sous-locations prohibées, afin de prévenir les contournements du statut des baux commerciaux et de garantir la loyauté contractuelle entre bailleur et preneur.
- L’analyse du contrat : la mise à disposition des lieux comme prestation principale
Pour déterminer la nature exacte des conventions conclues entre le preneur et les sociétés tierces, la Cour d’appel procède à une analyse particulièrement attentive de l’un des contrats produits aux débats. Plutôt que de s’en tenir à la dénomination retenue par les parties – en l’occurrence un prétendu « contrat de prestations de services » – les juges du fond s’attachent à en dégager la réalité économique et juridique. Cette démarche, pleinement conforme à la jurisprudence classique en matière de requalification, consiste à identifier l’objet véritable de la convention, tel qu’il résulte de son économie générale, de ses stipulations dominantes et des conditions concrètes dans lesquelles elle a été exécutée.
L’examen du contrat révèle tout d’abord que la seule prestation véritablement substantielle concerne l’utilisation des locaux eux-mêmes. Un article particulièrement développé traite exclusivement des modalités matérielles d’occupation de l’espace, de son organisation pratique et des conditions dans lesquelles la société tierce peut en disposer. À l’inverse, les prestations présentées comme des services annexes apparaissent marginales, accessoires et dépourvues d’autonomie. Elles ne prennent sens qu’en support de la mise à disposition des lieux et n’existent pas indépendamment de celle-ci. Cette disproportion manifeste entre les stipulations relatives à l’occupation physique des locaux et celles relatives aux services démontre que la convention repose essentiellement sur le transfert d’un espace d’exploitation plutôt que sur une véritable prestation immatérielle.
La Cour relève ensuite que les stipulations contractuelles organisent un transfert de jouissance totale au profit de la société tierce. Celle-ci dispose d’un contrôle exclusif sur l’accès au local, en assure la surveillance ainsi que la responsabilité pendant toute la durée de son occupation, et exerce en pratique un pouvoir d’administration complet sur l’espace concerné. Le locataire principal, quant à lui, ne conserve qu’un simple droit de visite, exercé sous réserve d’un préavis de quarante-huit heures, ce qui illustre la dépossession quasi totale de la jouissance des lieux. Cette situation traduit un basculement évident : le preneur, en cessant de maîtriser l’usage quotidien du local, se rapproche de la figure du bailleur intermédiaire plutôt que de celle d’un prestataire de services.
Enfin, les juges constatent que la société tierce verse une rémunération en contrepartie de l’occupation consentie. Cette contrepartie financière, directement corrélée à la mise à disposition des locaux, constitue un indice déterminant de la qualification de sous-location. Elle montre que l’avantage économique recherché par le locataire ne repose pas sur une prestation distincte, mais bien sur l’exploitation du local lui-même. La convention crée ainsi une situation où le locataire principal tire profit de l’usage du bien immobilier en transférant sa jouissance à un tiers, ce qui correspond en tous points à la logique de la sous-location.
Au terme de cette analyse, la Cour d’appel conclut que l’économie générale du contrat révèle une mise à disposition autonome et rémunérée d’un espace, équivalant à une véritable sous-location, indépendamment de l’intitulé qui lui a été donné. La qualification retenue par les parties importe peu : dès lors que le tiers bénéficie d’une jouissance réelle, exclusive et temporaire du local en échange d’un prix, la convention s’inscrit pleinement dans le champ de la sous-location prohibée au sens de l’article L. 145-31 du Code de commerce.
- Une pratique répétée : absence de transparence et généralisation des mises à disposition
L’analyse ne se limite pas au seul contrat produit par le locataire. La Cour d’appel s’intéresse également au contexte global dans lequel ces conventions ont été conclues et constate que la mise à disposition des locaux ne constituait pas un épisode isolé ou ponctuel. Il apparaît au contraire que le preneur avait conclu des accords similaires avec d’autres sociétés tierces, lesquelles avaient également bénéficié d’un accès aux lieux loués pour y exercer une activité ou y installer temporairement leurs équipements. Malgré les demandes du bailleur et les exigences normales de transparence inhérentes au litige, le locataire n’a pas été en mesure de produire les contrats encadrant ces mises à disposition supplémentaires.
Cette absence de communication est lourde de conséquences. Elle empêche non seulement de vérifier la nature exacte des relations contractuelles avec ces autres occupants, mais elle laisse surtout penser que le locataire n’assumait pas la transparence que requiert l’exécution d’un bail commercial, en particulier lorsque des tiers sont appelés à intervenir dans les lieux. Pour la Cour, cette réticence à produire les documents atteste d’une volonté manifeste de soustraire ces conventions au regard du bailleur et de la juridiction, ce qui constitue un indice fort d’un système organisé de sous-locations dissimulées.
Les juges observent d’ailleurs que, dans un environnement contractuel régulier et conforme à la logique de la prestation de services, le locataire n’aurait eu aucune difficulté à produire les accords conclus avec ces tiers : au contraire, leur communication aurait démontré que les prestations rendues étaient réelles, substantielles et prédominantes, et que la mise à disposition de l’espace n’en constituait qu’un simple support matériel. Le refus de les produire laisse donc supposer que ces conventions ne prévoyaient pas de services véritablement distincts et qu’elles reposaient, comme la première, sur un transfert de jouissance des lieux.
La Cour en déduit que le locataire avait mis en place une véritable activité parallèle de mise à disposition autonome des locaux à des entreprises extérieures, indépendamment de son activité principale et en méconnaissance complète du bail commercial. L’existence de plusieurs conventions non communiquées, toutes manifestement fondées sur le même schéma d’occupation, révèle une pratique répétée, incompatible avec l’utilisation personnelle du local par le preneur et avec le contrôle que le bailleur doit conserver sur l’identité des occupants.
En conséquence, les magistrats estiment que ces mises à disposition, réalisées de manière systématique, rémunérée et hors de tout encadrement contractuel déclaré, doivent être requalifiées en sous-locations prohibées, sans qu’il soit nécessaire d’examiner individuellement chacun des contrats non produits. Le caractère régulier, discret et organisé de ces pratiques suffit à démontrer que le locataire a violé de manière grave et persistante les stipulations essentielles du bail, privant ainsi le bailleur de toute visibilité sur l’usage de son propre bien.
- La conséquence juridique : la perte du droit à l’indemnité d’éviction
Au terme de son analyse, la Cour d’appel tire les conséquences directes des manquements imputés au locataire. Elle constate d’abord que les diverses mises à disposition des locaux ont été réalisées sans la moindre autorisation du bailleur, en violation frontale de la clause du bail interdisant toute sous-location, totale ou partielle, ainsi que tout prêt ou mise à disposition, même temporaire. Cette méconnaissance des stipulations contractuelles essentielles suffit déjà à caractériser une violation grave des obligations du preneur.
La juridiction relève ensuite que le locataire n’a jamais appelé le bailleur à concourir à l’un quelconque des actes, alors même que l’article L. 145-31 du Code de commerce impose de le faire systématiquement dès lors qu’une sous-location est envisagée. L’absence totale d’information et de transmission des projets de conventions – y compris a posteriori – confirme que les opérations ont été réalisées dans une opacité complète, empêchant le bailleur d’exercer son droit de contrôle sur l’identité des occupants, les conditions d’occupation et les modalités de rémunération consenties.
La Cour souligne également le caractère irréversible du manquement commis par le locataire. Contrairement à d’autres infractions contractuelles, qui peuvent être réparées ou régularisées à la suite d’une mise en demeure, la conclusion d’une sous-location prohibée produit des effets immédiats et définitifs : le transfert de jouissance a déjà eu lieu, les tiers ont déjà occupé les lieux, et le bailleur n’a pas été mis en mesure de s’y opposer ou de donner son accord. En raison de cette irréversibilité, la jurisprudence constante dispense le bailleur de toute mise en demeure préalable, laquelle serait dépourvue de portée effective.
Sur le fondement de l’article L. 145-17 du Code de commerce, la Cour déduit de l’ensemble de ces éléments l’existence d’un motif grave et légitime justifiant le refus de renouvellement du bail sans indemnité d’éviction. Le comportement du locataire, en organisant et en multipliant des sous-locations illicites, a rompu la confiance contractuelle et altéré de manière substantielle les droits du bailleur sur son propre bien. Dès lors, le preneur se trouve privé de tout droit à indemnisation, y compris de l’indemnité d’éviction initialement envisagée par le bailleur lors de la délivrance du congé.
La sanction prononcée est particulièrement sévère, mais elle résulte directement de la gravité des violations commises : le locataire, en cessant d’occuper personnellement les lieux et en tirant profit de leur mise à disposition autonome au profit de tiers, a détourné l’objet même du bail commercial et compromis l’équilibre contractuel initial. Il ne peut dès lors revendiquer la protection normalement accordée à l’exploitant commercial évincé.
- Mise en perspective : quels critères distinguent la mise à disposition licite de la sous-location prohibée ?
L’arrêt du 25 septembre 2025 offre une nouvelle illustration de la distinction, parfois délicate en pratique, entre la mise à disposition licite d’espaces assortie de services et la sous-location prohibée. Cette distinction n’est pas théorique : elle conditionne la validité du contrat conclu avec le tiers, l’opposabilité de ce contrat au bailleur, et surtout le maintien ou la perte du droit au renouvellement et à l’indemnité d’éviction. La Cour rappelle qu’il ne suffit jamais aux parties de qualifier leur convention de « prestation de services » pour échapper au régime contraignant de la sous-location ; la qualification retenue dépend exclusivement de la réalité de la jouissance consentie et des conditions concrètes dans lesquelles l’espace est mis à disposition.
La mise à disposition licite suppose que le locataire principal conserve un contrôle effectif et continu sur l’espace occupé par le tiers. Ce contrôle se manifeste notamment par la maîtrise de l’accès, la supervision constante de l’activité exercée, la gestion matérielle et fonctionnelle des lieux et la possibilité d’intervenir à tout moment pour en modifier l’usage. La mise à disposition ne doit pas conférer au tiers une jouissance exclusive ou autonome du local, mais s’inscrire dans un ensemble contractuel où le locataire demeure le véritable exploitant, fournissant des prestations de services substantielles : services techniques, administratifs, logistiques, accueil, encadrement, gestion des installations ou mise à disposition d’équipements spécialisés. Dans ce type de convention, l’occupation de l’espace n’est qu’un support accessoire, indissociable de la prestation principale rendue par le locataire. La transparence contractuelle demeure alors totale et le bailleur peut vérifier que son preneur n’a pas dénaturé l’usage du local.
À l’inverse, la sous-location prohibée se caractérise par un transfert de jouissance, même temporaire, du local ou d’une partie de celui-ci au profit du tiers. Lorsque la mise à disposition constitue l’objet principal du contrat, que le tiers dispose d’un espace autonome pour y exercer librement son activité, que le locataire perd la maîtrise opérationnelle des lieux, ou encore lorsque la rémunération versée par le tiers est directement corrélée à l’occupation de l’espace, la convention s’apparente nécessairement à une sous-location. Cette qualification s’impose même si le contrat prévoit, à la marge, quelques prestations accessoires de nettoyage, de maintenance ou de gestion administrative. Ce qui importe, pour la Cour, est l’analyse globale du rapport contractuel : dès lors que le tiers jouit du local comme s’il en était l’exploitant, le contrat bascule dans le champ de l’article L. 145-31 du Code de commerce.
L’arrêt du 25 septembre 2025 illustre de manière exemplaire cette grille de lecture. Les juges n’ont jamais entendu s’en remettre à la seule qualification donnée par les parties ; ils ont recherché la substance du contrat, et non son apparence. En constatant que la mise à disposition des locaux était la prestation dominante, que le tiers avait une autonomie totale d’occupation et que le locataire n’intervenait qu’à la marge, ils ont logiquement conclu que la convention relevait de la sous-location. Cette analyse, qui s’inscrit dans une jurisprudence désormais constante, rappelle aux praticiens que la mise à disposition d’un espace ne devient licite que si elle reste étroitement encadrée, contrôlée et accessoires par rapport aux services fournis.
Ainsi, la Cour d’appel de Paris réaffirme un principe fondamental du droit des baux commerciaux : la qualification d’un contrat ne dépend jamais de son intitulé, mais uniquement de la réalité de la jouissance accordée au tiers. Toute convention qui confère à un tiers une jouissance autonome, exclusive ou rémunérée d’un local loué s’analyse en une sous-location, même si elle est habilement présentée comme une prestation de services. Ce rappel est d’autant plus précieux que les pratiques contemporaines (coworking, pop-up stores, sharing economy, espaces mutualisés) amplifient les risques de requalification et exigent une vigilance contractuelle renforcée.
Conclusion
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 25 septembre 2025 confirme avec netteté une ligne jurisprudentielle désormais bien établie : les conventions qualifiées par les parties de « prestations de services » ne résistent pas à l’analyse dès lors qu’elles ont pour objet principal de mettre des locaux à disposition d’un tiers et qu’elles conduisent, en pratique, à un transfert de jouissance autonome. Peu importe l’habillage contractuel retenu ou la volonté affichée par le locataire : c’est la réalité économique de la relation qui prévaut sur la dénomination choisie.
Cette décision rappelle que la sous-location prohibée constitue un manquement grave, entraînant des conséquences particulièrement lourdes. Le locataire qui organise la mutualisation de son espace – qu’il s’agisse de pop-up stores, de corners intégrés, d’événements ponctuels ou d’activités de coworking indépendantes – doit veiller à ce que la mise à disposition reste accessoire, encadrée et strictement contrôlée, faute de quoi la convention s’expose à une requalification immédiate. Une vigilance accrue est indispensable, tant dans la rédaction des conventions que dans leur exécution, notamment s’agissant du maintien du contrôle effectif des lieux et de la transparence à l’égard du bailleur.
La sanction attachée à la qualification de sous-location illicite est d’une particulière sévérité. Au-delà du risque de résiliation du bail ou d’acquisition de la clause résolutoire, le locataire fautif s’expose surtout à la perte du droit à l’indemnité d’éviction, pourtant pierre angulaire de la protection conférée par le statut des baux commerciaux. En privant le preneur de cette indemnité, la jurisprudence rappelle que la loyauté contractuelle et le respect de la destination du bail constituent des obligations essentielles, dont la violation ne peut rester sans conséquence.
En définitive, cette décision s’inscrit dans une logique de protection du bailleur et de préservation du cadre légal du bail commercial, tout en offrant aux praticiens une grille de lecture opérationnelle pour distinguer avec précision les mises à disposition licites des sous-locations prohibées. Elle constitue un signal clair adressé aux locataires : la mise à disposition d’espaces ne saurait devenir un mode d’exploitation détourné du bail, sauf à s’exposer à la perte des droits les plus fondamentaux attachés à leur statut.